Pourquoi le gouvernement veut dissoudre le GUD
Première parution : Nicolas Lebourg, « Pourquoi le gouvernement veut dissoudre le GUD », Libération, 20 juin 2024.
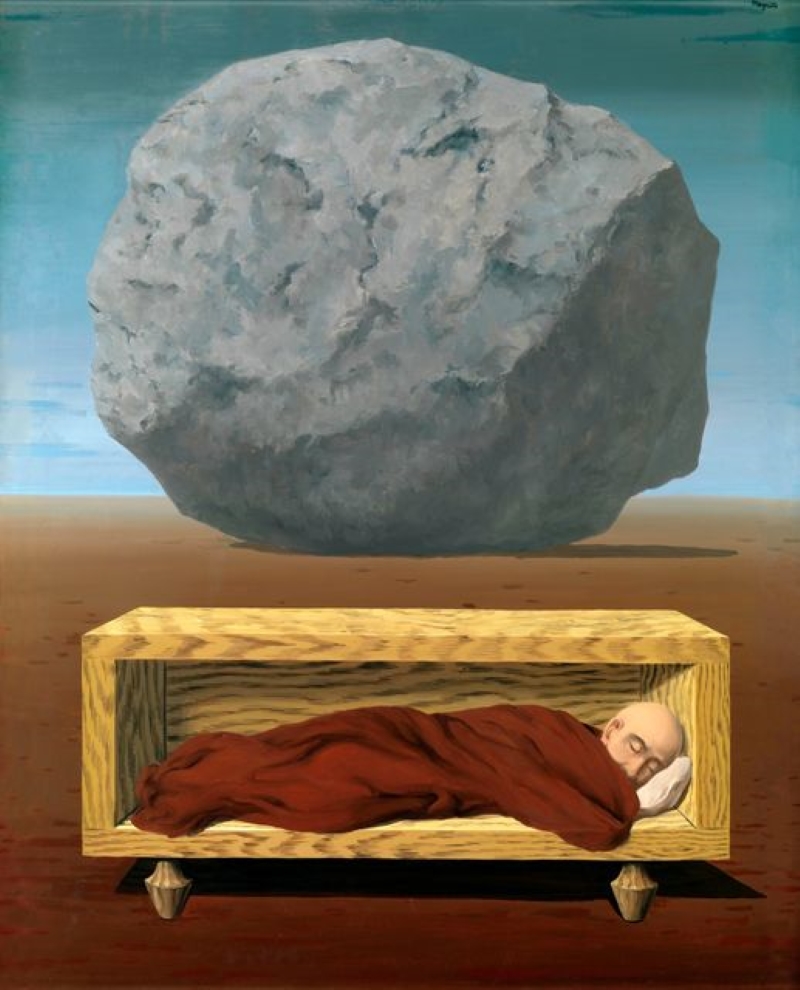
Gérald Darmanin a annoncé sa volonté de dissoudre le GUD, le plus célèbre des mouvements violents d’extrême droite. Jordan Bardella répondu que premier ministre il dissoudrait tous les mouvements ultras, de gauche comme de droite. Une promesse qui oublie qu’il n’en a absolument pas le pouvoir puisque c’est le président de la République qui peut dissoudre un groupement dans le cadre de l’application de l’article 212-1 du Code de sécurité intérieure. Passée cette erreur juridique, demeure le fond de la question : pourquoi ces deux positions ?
Le GUD : mythes et réalités
Le GUD naît sous le nom d’Union Droit après la dissolution en octobre 1968 du Mouvement Occident. Il en a la même ligne (néofascisme, anticommunisme, antisémitisme) et les mêmes méthodes (la violence est vu comme l’acte politique pur). Il se présente en revanche comme un syndicat étudiant, pour se démarquer d’Occident. Il se rebaptise vite « Groupe Union droit ». La résurrection d’un groupe rageusement antimarxiste correspond à une attente seulement quelques mois après Mai 68. Très rapidement le GUD s’étend grâce à une efficace politique de violence publicitaire : en attaquant les gauchistes publiquement, le GUD montre à tous les militants isolés ou membres d’autres groupuscules qu’il est le fer de lance de l’extrême droite. Cela lui permet de lancer le mouvement Ordre nouveau fin 1969, un choix d’intitulé qui correspond à la signature alors laissée lors d’attentats contre des cafés fréquentés par des Maghrébins. Les chefs du GUD absorbent les autres groupuscules, quitte à tabasser leur direction pour mieux les convaincre. ON se développe et fonde à son tour le Front national en 1972. La violence militante aboutit à la dissolution d’ON en 1973. Les chefs décident de changer le sens de la lettre « D » du sigle, qui désormais veut dire « Défense ». Ils imaginent que cela les préserve d’un risque de dissolution. C’est d’une naïveté juridique ahurissante.
Mais s’amorce une particularité du GUD : il survit aux dissolutions. Il n’est pas dissout avec ON dont il est le mouvement de jeunesse en 1973. Il occupe la même place auprès d’Unité radicale quand celle-ci est dissoute en 2002. Il est à l’origine du Bastion social, dissout avec six de ses appendices en 2019, mais avec un GUD encore épargné. Il survit même à ses propres dissolutions : après l’échec piteux d’une attaque contre l’université de Nanterre et la victoire de la gauche aux élections présidentielles le GUD s’auto-dissout en 1981. Il ressuscitera peu après, « GUD » n’étant qu’une marque dont on peut se saisir pour peu que les générations précédentes vous en reconnaissent la légitimité – c’est là l’esthétique aristocratique du groupe qui se dit « groupuscule des dieux » ou « Waffen Assas », mais qui trahit ainsi un de ses préceptes fondateurs : que la jeunesse n’obéisse qu’à la jeunesse.
Pourquoi dissoudre le GUD ?
Pourquoi le GUD n’a-t-il pas été interdit avant ? Il remplit les conditions à la fois pour des raisons idéologiques (il n’a jamais caché son néofascisme) et comportementales. Sa violence dans les années 1970 demeurait concentrée sur des cibles jugées marxistes, mais à partir des années 1980 les violences racistes deviennent courantes. Dans les années 1990, le journal du GUD demandait à ses lecteurs de se procurer des armes dans la perspective de la « guerre ethnique », et affirmait que les jeunes européens devaient prendre les kamikazes palestiniens en modèle. Tout le long de sa carrière, le GUD a également commis des violences contre d’autres groupes d’extrême droite, étant un voisin difficile.
Il était donc fort simple de dissoudre le mouvement. Le laisser exister avait toutefois un immense mérite : le légendaire du GUD fait que seuls des militants particulièrement radicaux et adeptes de la violence pouvaient se saisir d’une telle étiquette. Par là-même on avait un secteur qui s’auto-désignait comme à surveiller.
Y a-t-il une raison spécifique à le dissoudre aujourd’hui ? Il y a plutôt un faisceau d’éléments. La rumeur d’une possible dissolution du GUD courait depuis plusieurs mois. L’Intérieur est en effet sensible à la radicalisation de l’ultra droite. Celle-ci est notable à la fois dans l’activisme violent, et les évènements à Roman-sur-Isère l’été dernier ont montré que le milieu avait passé un cap tant en matière d’organisation que de détermination. Mais il y a aussi une véritable tentation terroriste : nous en sommes désormais à 13 attaques déjouées depuis 2017. Enfin, cela correspond à la pratique macroniste de la dissolution : si celle-ci est permise depuis 1936 le quart de celles qui ont eu lieu l’ont été sous la présidence d’Emmanuel Macron, et elles ont visé l’extrême droite pour le tiers d’entre elles. La pratique macroniste du dispositif relève clairement d’une myriade de coups tactiques plutôt que d’une stratégie d’ordre public.
Bien sûr ces éléments rencontrent aussi l’agenda électoral, en permettant à la majorité de se présenter comme un rempart de la République contre « tous les extrémismes ». Pour autant, force est de constater que l’étude de la fréquence des violences du GUD montre que celle-ci est fonction de l’intensité de la mobilisation des gauches. En cette période de « Front populaire », la dissolution du GUD peut avoir été vue par l’Intérieur comme ayant une valeur préventive de maintien de l’ordre.
Jordan Bardella, quant à lui, essaye de doubler la majorité sur le créneau « la loi et l’ordre » en affirmant que premier ministre il dissoudra les radicaux des deux bords. Outre l’erreur juridique que cela représente, cette vision n’est partagée par aucun des services de sécurité français. D’une part, car cela reviendrait à semer le chaos dans la surveillance des radicaux. D’autre part, tous les services de renseignement convergent dans l’idée que si la menace djihadiste demeure la première inquiétude, l’ultra droite représente la seconde, les violences d’ultra gauche n’étant absolument pas engagées de la même manière dans la tentation terroriste.