Qu’est-ce que “le social” ? [2/2]
En l'état de la gestion de politiques publiques aussi imbriquées dans la structure même de la plus-value que dans le « substrat social », le temps n'est plus à l'action collective, syndicale ou mutualiste, mais appartient à la seule organisation publique. La politique du logement social nous le montre en étant le plus souvent une politique du « sparadrap sur la jambe de bois ». La richesse de l'exploitation du bâti, parfaitement développée dans une France de la rente, hiérarchise l'espace selon la loi de la plus-value, plus encore que par les valeurs de la classe sociale des possédants. Rendue à l'autonomie du capital, la gestion de l'espace dépend totalement de son exploitation. Développer le logement social, correspond alors aux mêmes règles d'entropie du logement locatif. Il compense et régule les prix des loyers, mais simultanément contribue aux équilibres de l'usage des espaces et à leur nominalisation.
Le logement social porte alors souvent le fardeau qui le qualifie. La massification des politiques de logement, en grand espace concentré, par les effets des programmes législatifs de défiscalisation ou d’investissement direct des collectivités, génère des quartiers, des zones, des banlieues. Les politiques sociales ne doivent pas générer des ghettos, qu’elles sont censées supprimer, mais favoriser la mixité sociale, ce qui n’arrange pas toujours les intérêts de l’industrie du bâtiment. L’institution « défend la société » selon la loi de ses intérêts.
Du Rouge au vert
Nous n’avons plus à nous considérer comme enfant de la guerre, celle-là même qui se présentait comme relation permanente, déterminant « les relations d’inégalité, les dissymétries, les divisions de travail, les rapports d’exploitation ». Nous pouvons assimiler les conditions de réalisation d’une société plus pondérée et plus mesurée, pour pouvoir limiter d’ores et déjà d’autres sources de nos abus. L’inachèvement de la question sociale intervient au moment où d’autres nécessités, d’autres dépenses d’intérêts collectifs viennent s’y substituer. Nous n’aurons pas assumer notre dette sociale, que s’affirme désormais une incontournable dette écologique. Le risque environnemental se substitue au risque social, tant par sa détermination internationale que constitutionnelle, tant par sa fiscalisation que par la graduation de l’investissement public. Le risque environnemental devient ce qui nous renvoie à notre état de nature, qui par voie d’incidence, se hiérarchise dans l’ordre des priorités au-dessus des risques sociaux. Dans cette concurrence des risques, le social semble défait. Nul ne pourra contester que la survie soit déconsidérée par le seul ordre de la vie.
Année Zéro
La question sociale, mais au plus large tous les thèmes sociétaux, sont l’otage des stratégies du capital et du politique à s’autogouverner dans la courte durée. Plus de richesse et plus de pouvoir, la société sans partage se profile désormais au plus grand nombre. L’alternative ne se situe-elle pas dans la seule négation du pouvoir ? Comment résister toute une vie à une société qui connaît ses problèmes, maîtrise ses solutions, et au final les perpétue pour les intérêts d’une minorité ? On aurait pu croire que le rallongement de la durée de la vie aurait généré une plus grande sagesse humaine. En l’état, il n’en est rien. La question sociale n’est pas une priorité assumée d’un État qui s’est pourtant construit sur sa seule fonction protectrice. La baisse d’intensité des rapports de forces, l’effondrement du communisme, l’émiettement social, l’augmentation de la qualité de la vie, la désyndicalisation, le vieillissement global de la population sont autant de faits qui attestent de la difficulté à imposer les interventions publiques dans le domaine sanitaire et social. Le spectre des dettes publiques, dont tout le monde a oublié que leur réduction tendait à faire converger les économies européennes, non à les soumettre à l’ordre de la récession libérale, est désormais cet objectif zéro à atteindre. L’État soliloque sa puissance en s’interdisant ce qu’il peut faire. Le fonctionnement public le plus adéquat est forcément que la puissance feigne l’impuissance. Que les caisses soient vides pour les uns, et que les caisses soient pleines pour les autres, les choix s’orientent toujours sur le vieux principe que l’on ne prête qu’aux riches, que seule la structure économique nécessite l’intervention publique, que le secteur social ne mérite pas ce soutien pour sa mythique improductivité.
Depuis 1992, pourtant, l’invention et le développement effrénés de la fiscalité sociale montrent que sous le couvert des dysfonctionnements de la gestion corporatiste, la puissance publique a nationalisé une recette, et depuis, elle rationalise les dépenses pour produire à bon compte de l’argent public. La fiscalité ne diminue pas durant cette période. Elle est croissante, mais surtout, elle connaît une translation de prélèvements obligatoires grevant les revenus du capital vers des prélèvements obligatoires grevant les ressources du travail. La fiscalité ne frappe plus des minorités riches, elle se diffuse vers des majorités pauvres, et de plus en plus vers une classe moyenne progressivement appauvrie. Le chômeu,r intimé de travailler, et le travailleur contraint de payer ses prélèvements sociaux en constante augmentation, sont confrontés à cet imaginaire libéral déroutant, qui fait que l’impôt frappant les plus nantis est présenté comme injuste, improductif, irréaliste. Pour reprendre les termes si justes de Gilles Deleuze et de Félix Guattari, « le cynisme est le capital comme moyen d’extorquer du surtravail, mais la piété est ce même capital comme capital-Dieu d’où semblent émaner toutes les forces du travail ».
A Présent
Les fondements réels du désinvestissement des institutions relèvent de cette vision négative de la société des individus. Une idée forgée par les courants néolibéraux de l’après-guerre, dont le sens idéologique procède toujours de cette même vacuité naturaliste, a traité la société des hommes selon la loi de la jungle, selon des termes nous ramenant plus dans l’imaginaire de Léon Walras que dans celui d’Adam Smith. Voici fait de la sociologie au nom de l’économie. L’ordre et le marché ont alors cette fonction archaïque de dresser les sujets aux conditions de la production, pour faire que l’on attribue à ceux qui possèdent, le statut nobiliaire qui leur serait dû : aux aristocraties du sang et de la guerre, succèdent les aristocraties de l’argent et du vide. C’est le paradoxe de notre temps, que de constater que les possédants relancent la lutte des classes, tout en affirmant qu’elle n’existe plus. C’est le propre du capital que de minimiser ses faiblesses économiques, pour n’afficher que des ambitions cherchant à modifier l’ordre politique de la société. Ce retour de l’histoire, nous ne pouvons que le constater, c’est celui-là qui menace le plus le social, tout-à-coup contraint de se désintégrer sous le couvert d’une liberté une fois de plus abusée.
Le temps qu’il nous appartient de vivre est alors menacé. Cette menace est une stratégie de contrôle social extrêmement aboutie. La seule échappatoire consiste dans l’inversion du savoir. Par l’instauration intégrée du savoir social, pour que la société se gouverne de plus en plus, pour que les individus décident des rythmes de travail et de socialité tout au long de leur vie : voilà des alternatives qui pourraient se construire.
En savoir plus sur Fragments sur les Temps Présents
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.
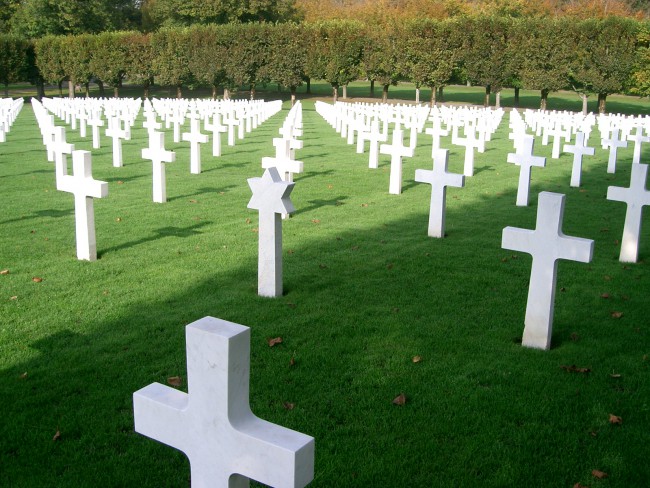
Laisser un commentaire